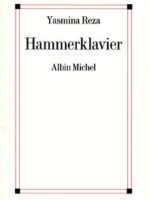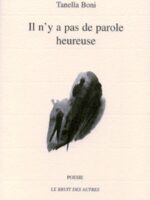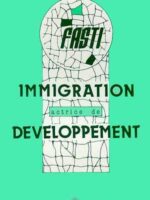Recommended Books
-
Etats d’enfance s-5 – TEXTE DE ROBERTO KOCH
R315,16Francesco Zizola est de ceux qui, avec l’UNICEF, ont choisi de témoigner par l’image des formes multiples de l’exploitation des enfants à travers le monde.
-
Etonner les dieux
R348,82Nvisible, il a quitté son pays pour trouver le secret de la visibilité. Débarqué sur une îlconnue après sept ans de voyage, il traverse une ville étrange et déserte. Des voix lui parlent et le guident dans un monde merveilleux où princesses, prophètes et licornes le mettent à l’épreuve : un parcours initiatique qui le mènera à percer le mystère de son destin.
Né en 1959, Ben Okri est un poète et romancier nigérian. Il a dirigé la section « Poésie » du West Africa Magazine pendant sept ans. Considéré comme une figure de proue de la littérature postcoloniale anglaise, il a reçu le Booker Prize en 1991 pour La Route de la faim.
« Il est peu de livre aussi entraînant et lumineux que cet Étonnement des dieux. »
La République des lettres
-
-
Femmes fragmentées
R233,16Noires, blanches, les héroïnes de ces nouvelles expriment, chacune selon son tempérament et son histoire, le mal-être de la femme universelle dans une société où les rôles traditionnels se fondent peu à peu dans une uniformité sans repères. Telles des naufragées, leur instinct de survie les pousse à la recherche désespérée d’une nouvelle identité.
Noires, blanches, les héroïnes de Femmes Fragmentées expriment chacune selon son tempérament et son histoire, le mal-être de la femme universelle dans une société où les rôles traditionnels se fondent peu à peu dans une uniformité sans repères. Telles des naufragées, leur instinct de survie les pousse à la recherche désespérée d’une nouvelle identité.
Femmes Fragmentées – premier recueil de Marie-Félicité Ebokea – est en fait, une tentative de rapprochement entre deux univers fondamentalement différents, par un phénomène de complémentarité où l’un s’enrichit au contact de l’autre. Citoyenne du monde, cette jeune écrivaine y dévoile sa vision pluri-culturelle de la vie qui s’appuie sur sa double expérience du Cameroun et de la France.
Le style de Marie-Félicité Ebokea est à l’image de son époque et de sa quête personnelle ; alerte, dépouillé, direct. Tantôt cru, tantôt recherché, il illustre l’attitude de cet auteur qui souhaite rester à l’écart de toute catégorisation.
-
Hammerklavier
R318,22« J’ai fait le rêve suivant. Mon père mort revenait me voir.
– Alors, lui dis-je, comment est-ce ? As-tu rencontré Beethoven ?
Il se renfrogne et secoue la tête avec dégoût et tristesse :
– Ah, la, la ! Horrible rencontre !
– Comment ça ?
– Très antipathique. Très.
– Mais comment, papa ?
– Je m’approche de lui, poursuit mon père, prêt à le serrer, sais-tu ce qu’il me dit :
« Comment avez-vous osé vous attaquer Adagio d’Hammerklavier ! Comment avez-vous pu une seule seconde vous imaginer interpréter une mesure d’Hammerklavier ? »
– Pardonnez-moi maître, lui répondit mon père, je vous imaginais au-dessus de ça à présent…
– Mais enfin ! s’écrie Beethoven, être mort n’est pas être sage ! »Ce récit a reçu le Prix de la Nouvelle de l’Académie Française en 1997.
-
Histoire d’Awu
R370,24Awu ne demande chaque jour qu’à coudre sa vie au point de l’amour. Bon père, bon époux, Obame Afane a le courage de ses veines où coule aussi de l’encre rouge. Mais, cathédrale accablante aux fondements jaloux et possessifs, la forêt inextricable, porteuse d’une vie et d’une mort extrêmes, doit toujours triompher. Avec innocence brutale, Histoire d’Awu raconte l’indicible réalité que vit Awudabiran’, dite Awu, comme un cri de tendresse cruelle, dans un village au cœur de l’Afrique noire d’aujourd’hui, quand s’effilent ou s’ensauvagent tous les codes et les repères.
-
Histoire de l’Afrique noire
R659,39Ouvrage de fond sur sur un large panorama historique : de la préhistoire jusqu’aux problèmes de l’Afrique d’aujourd’hui. J. Ki-Zerbo est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques, secrétaire général de l’U.P.V. (Union Progressiste Voltaïque) et de l’I.A.F.D. (Internationale Africaine des Forces pour le développement), professeur d’histoire au Centre d’Enseignement Supérieur de Ouagadougou, auteur de plusieurs ouvrages sur l’Afrique et d’articles.
-
Histoire de la colonisation française – Flux et reflux (1815-1962)
R772,91Au lendemain de l’écroulement de la puissance napoléonienne, la monarchie bourbonienne restaurée met beaucoup d’acharnement à récupérer les quelques territoires que l’Angleterre a accepté de lui restituer. Dans les derniers jours du règne de Charles X, l’expédition d’Alger, origine opération de politique extérieure, inaugure une reprise de l’expansion qui ira s’amplifiant sous la Monarchie de Juillet, le Second Empire et plus encore la Troisième République.
Ainsi s’est constitué le second empire colonial français, même si l’opinion et le personnel politique ne vibrent pas unanimement, loin de là, aux entreprises et aux succès de leurs soldats, de leurs fonctionnaires, de leurs missionnaires.
Pourtant, avec la fin des opérations de conquête, les Français se rallient, de plus en plus nombreux, idée de l’empire, à laquelle l’Exposition de 1931 les sensibilise davantage. Au lendemain de la Libération, ils communient brièvement dans l’illusion de constituer avec les peuples d’outre-mer une grande » Union française fraternelle « .
Or la Seconde Guerre mondiale, avec l’entrée en scène de puissances extra-européennes, a profondément ébranlé un édifice tenu pour indestructible. Avec une répugnance tempérée de résignation, la France se défera en peu d’années de l’essentiel de ses possessions: dans le sang et le drame (Indochine, Algérie…), ou bien dans la concertation (Afrique noire). Le prestige de De Gaulle, qui comprit, en dépit de ses préférences personnelles, la nécessité historique de cette évolution, aida grandement la nation à franchir ce cap.
-
Histoire de la colonisation française – Le premier empire colonial-Des origines à la Restauration
R1195,16L’ancienne France, qui avait au Moyen Age conquis l’Angleterre, fondé le royaume de Sicile et participé à la création des Etats francs d’Orient, reste sur la réserve quand, aux XVe et XVIe siècles, Portugais et Espagnols se partagent le monde. En dépit de l’absence politique de la nation, des négociants et des marins issus des provinces maritimes sillonnent les eaux du globe, commerçant, pêchant, s’essayant même, en violation du monopole ibérique, à quelques tentatives d’installation. La révolte des Hollandais contre les Espagnols et leur assaut victorieux contre l’Asie portugaise des épices entraînent bientôt Français et Anglais dans la voie des conquêtes durables.
Alors que le roi de France demeure en Europe prisonnier des guerres extérieures et civiles, des aventuriers lui offrent un empire colonial: la Nouvelle-France, Terre-Neuve, la Guyane, les Antilles, la Louisiane, les Mascareignes, Pondichéry. Quoique peu peuplé et mal défendu, ce domaine d’outre-mer prend conscience de sa réalité sous Colbert. Pourtant, à la fin de son règne, Louis XIV concède un premier démembrement de ses possessions aux Anglais. En 1763, Louis XV ne possède plus que quelques îles et quelques comptoirs. C’est alors que la disparition de l’empire territorial en friche révèle la richesse de l’empire commercial antillais qui permet à la France de dominer le marché des sucres et des cafés. Mais bientôt, à Saint-Domingue, la Révolution sonne l’heure du soulèvement des esclaves. Napoléon, malgré les moyens qu’il met en œuvre pour anéantir l’Angleterre et s’approprier son empire colonial, échoue. La » seconde guerre de Cent Ans « , commencée sous le Grand Roi, s’achève: la Grande-Bretagne exerce une hégémonie planétaire qu’elle conservera jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
-
Histoire des colonisations. Des conquêtes aux indépendances (XIIIe-XXe siècle)
R739,25Pour la première fois, un historien présente et analyse l’ensemble des phénomènes de la colonisation depuis leur origine jusqu’à leur fin – voire leur survivance.
Marc Ferro traite de toutes les pratiques coloniales des Européens, russes y comprises, mais également de la colonisation arabe, turque, japonaise, pour établir leurs points communs, leurs différences. Le point de vue des ex-colonisés est présenté, et pas seulement la vision européo-centrique de l’histoire ou celle des vainqueurs – avec les silences des uns et des autres…
Mettant l’accent sur le nouveau type de sociétés et d’économies nées de cette expansion puis de ce repli, l’auteur montre enfin comment les mouvements d’indépendance ont eu leurs effets télescopés par la mondialisation de l’économie, et plus récemment par un phénomène qu’il appelle l’impérialisme multinational.
-
il a dit il n’a pas dit
R177,78Pendant les vacances de Noël, Cyril est allé dans le désert de Mauritanie avec sa mère. À la fin du jour, sa mère est en larmes, les touristes s’inquiètent : Cyril a disparu. Au lever du soleil, Cyril est seul dans le désert. « Ils sont tous partis », lui dit une petite voix, celle de Scarabée noir, qui serami, le guide de l’enfant. Cyril est baptisé, il s’appellera Nasrany qui signifie « l’étranger occidental ». Cyril suit Scarabée noir qui l’entraîne dans l’étendue de sablfini jusqu’au Grand Juge Cadi qui siège sur la plus haute dune ; il est le seul à pouvoir retrouver sa mère.
Mais le juge est bien fatigué et il a d’autres affaires à juger et d’abord, celle d’Ely le Voyageur et de Hérisson Chanteur. Ely a été charmé par la voix sublime de Hérisson. Ce dernier en a profité, il a peu à peu dépouillé Ely le Voyageur de tous ses biens sous le prétexte qu’il en avait besoin pour chanter encore et encore. Hérisson est-il coupable ? Cyril écoute le jugement, il devra attendre jusqu’à la semaine suivante. Mais la semaine suivante, le juge a une affaire urgente : il doit juger la belle gazelle Aïcha qui charme Cyril lui-même : la danseuse, la fugueuse, la voleuse. Faut-il la condamner ? Le juge Cadi le dira et Cyril attendra et il lui faudra encore revenir. Enfin, c’est le terme du voyage. Devant les habitants du désert, Cyril retrouve sa mère. Il est heureux et il est malheureux. Comment abandonner Scarabée noir son ami ? Cyril emmène Scarabée noir avec lui, dans sa chambre, il lui reconstruit un désert, mais Scarabée noir dépérit, il est trop loin du désert de Mauritanie. Cyril devra choisir. Il préférera le bonheur de son ami. -
Il n’y a pas de petite querelle
R344,23Contes traditionnels du Mali ou d’ailleurs, ces « nouveaux contes de la savane » sont rapportés et développés par Amadou Hampâté Bâ dans le style plein de vivacité, d’humour et de poésie qui est le sien.
Qu’il s’agisse de grands récits d’aventures mêlés de fantastique, de satires morales ou sociales, de contes humoristiques ou de tranches de vie savoureuses, on y trouvera non seulement un vif plaisir de lecture et de dépaysement, mais aussi de nombreux sujets de réflexion dont l’actualité est de tous les temps.
Certains de ces contes projettent en effet une lumière particulière sur divers défauts ou qualités de la nature humaine ; d’autres stigmatisent certaines tares sociales : tentation du despotisme, fanatisme religieux, indifférence devant les conflits qui ne nous concernent pas, etc. ; d’autres enfin, à travers les aventures de personnages d’exception cachés sous des dehors repoussants, nous invitent à ne jamais juger d’après les apparences…
-
-
Inhumanitaire ou le cannibalisme guerrier à l’ère néolibérale (L’)
R437,55Quand ils ne suscitent pas l’admiration obscène pour la « toute-puissance » de la technologie, les conflits militaires de cette fin de siècle provoquent le sentiment d’un déchaînement de violence irrationnelle et archaïque. Mais la guerre et ses horreurs n’appartiennent-elles qu’au passé de l’humanité? Ou bien, sous des apparences chaotiques, une logique les relie-t-elle au monde d’aujourdhui ? Bernard Doray, psychiatre, nous conduit à sa suite sur quelques-uns des grands champs de souffrance contemporains. à Sarajevo, où s’active l’enfant dénicheur de bombes, en Algérie, auprès d’Abdelnasser, dont les dessins sont autant d’efforts pour donner sens à ce qu’il a vécu, au Rwanda, pour entendre le récit dantesque de « Marie-Goretti », au Chiapas, en Tchétchénie, au Vietnam… C’est l’envers, en quelque sorte, de l’humanitaire, la face obscure de l’ordre du monde : guerre aux enfants, guerre aux ventres, guerre à la mémoire, guerre à l’humain en l’homme. Ce qui se marque là, à travers bourreaux et victimes, c’est, pense Bernard Doray, la réalité d’un processus de d’ésymbolisation de grande ampleur : processus qui a beaucoup à voir avec la formidable poussée du capitalisme globalisé. Le néolibéralisme dans ses œuvres. version définitive. Quand ils ne suscitent pas l’admiration « obscène de la technologie », les conflits militaires de cette fin de siècle provoquent le « sentiment d’un déchaînement de violence irrationnelle et archaïque ». Mais la guerre et ses horreurs appartiennent-elles au passé de l’humanité ? Ou bien, sous des apparences chaotiques, une logique les relie-t-elle au monde d’aujourdhui ? Psychiatre, psychanalyste, Bernard Doray nous conduit à sa suite sur quelques-uns des grands champs de souffrance contemporains. À Sarajevo, où s’active l’enfant dénicheur de bombes ; en Algérie, auprès d’Abdelnasser, dont les dessins sont autant d’efforts pour donner sens à ce qu’il a vécu ; au Rwanda, pour entendre le récit dantesque de « Marie-Goretti » ; au Chiapas, au Guatemala, en Tchétchénie, au Vietnam… S’y dévoile, en quelque sorte, l’envers de l’humanitaire, la face obscure de l’ordre du monde : guerre aux enfants, guerre aux ventres, guerre à la mémoire, guerre à l’humain en l’homme ! Ce qui se marque là, à travers bourreaux et victimes, c’est, pense Bernard Doray, la réalité d’un processus de dé symbolisation de grande ampleur processus qui a tout à voir avec la formidable poussée du capitalisme globalisé. Le néolibéralisme dans ses oeuvres…